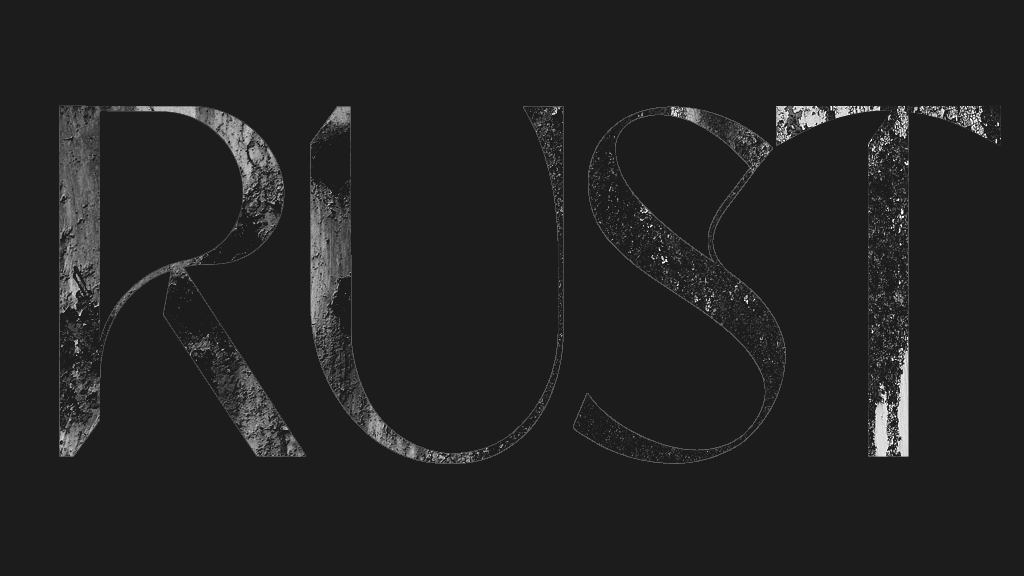Dever To Laye – De la musique extrême à la mélancolie des synthétiseurs

Avec INIT, son premier album à paraître le 26 mars sur Autoscopy Records, le compositeur parisien Dever To Laye façonne une musique qui explore les souvenirs, forgeant une sonorité où la lenteur et la répétition sont au cœur de chaque composition. Portée par les influences d’Alessandro Cortini, Max Richter et Rafael Anton Irisarri, la musique de Dever To Laye évoque des souvenirs ancrés dans le village auvergnat Vertolaye, où le temps semble suspendu, s’étirant pour mieux se révéler.

Une approche artisanale de la musique électronique
Après avoir été guitariste dans le groupe TLRVT jusqu’en 2019, puis bassiste de Cymbaline jusqu’en 2022, Adrien Brunel a aussi composé pour le cinéma (Bien Mignonne, Gertrude et Yvan Party Hard), pour des œuvres numériques et installations muséales. Son parcours oscille entre expérimentations sonores et travail manuel : maquettiste prototypiste dans une agence d’architecture, il a toujours cultivé une démarche artisanale dans son approche de la musique.
Closed Polysurface, est le premier clip qui introduit l’univers de Dever To Laye. À travers des textures rugueuses et des nappes en tension, il y explore un paysage sonore teinté de mélancolie. Si Dever To Laye ne connaît pas encore son public, son projet s’impose déjà comme une proposition sincère, où la musique prime sur toute forme de mise en scène. Rust est allé à la rencontre de cet artisan de la musique, pour découvrir la genèse de ce premier album.
Tu as été guitariste et bassiste dans les groupes Cymbaline et TVLTR, également compositeur pour des courts-métrages et des œuvres numériques intégrées à des installations. Tu as également réalisé des compositions d’ambiance pour des musées et tu travailles comme maquettiste prototypiste en agence d’architecture. Aujourd’hui, tu lances ton projet musical solo Dever To Laye. Est-ce que cette aventure est née simplement de ton départ du groupe Cymbaline pour te consacrer à ta propre musique, ou y avait-il d’autres motivations derrière cette transition ?
Il y en a plusieurs. Mais je crois qu’il y avait surtout une certaine lassitude du jeu en groupe, de manière générale. J’en fais depuis que j’ai 17 ans, et j’en ai eu marre des choses qui se répètent. Ça fait 20 ans que je fais la même chose. Au bout d’un moment, j’ai ressenti le besoin de changement. Et puis, il y a aussi les circonstances de la vie : je me suis senti bien, en couple, avec l’envie d’avoir un enfant. Je me suis dit que je risquais de devenir un poids pour le groupe, qui avait de vraies ambitions de professionnalisation. De mon côté, j’ai un boulot très prenant, 50 heures par semaine, un projet solo, Dever To Laye, que je n’avais pas le temps de mener à bien… Il fallait prendre une décision. J’ai donc choisi de partir. Cymbaline continue et ils ont trouvé un super bassiste. On est toujours très bons copains, mais honnêtement, jouer en groupe ne me manque pas du tout. Comme quoi, deux ans après, je me dis que c’était la bonne décision. Par contre, la scène me manque. Deux ans sans live, ça ne m’était presque jamais arrivé, et j’ai vraiment hâte de m’y remettre.
Tu dis que le live te manque. Mais avec ce projet solo, qui est plus individuel et centré sur les machines, notamment les modulaires, est-ce que ce changement d’instruments a fait partie de ta démarche ? En passant des cordes aux potards, y avait-il aussi une volonté de rupture avec les instruments plus acoustiques ?
Non, pas du tout ! Ça s’est fait naturellement, mais je n’avais pas spécialement envie de laisser tomber la guitare. Si on remonte un peu en arrière, j’ai toujours été guitariste ou bassiste dans mes groupes, principalement dans des styles très extrêmes comme le grindcore et le death metal. À cette époque-là, je ne ressentais absolument pas le besoin d’explorer autre chose. Puis, en 2011, j’ai dû subir une opération du poignet et faire une pause d’un an avec la guitare. J’avais toujours envie de faire de la musique, alors j’ai commencé à explorer d’autres approches, d’abord avec l’ordinateur. Mais honnêtement, je n’y ai pas trouvé beaucoup de plaisir. J’avais vraiment envie de mieux comprendre la production, la musique électronique, comment créer autrement qu’avec une guitare… Mais face à l’ordinateur, ça ne fonctionnait pas pour moi. Je ne suis pas très à l’aise avec ces outils, j’ai l’impression de ne pas avoir grandi avec. C’est plus tard, en découvrant les synthétiseurs analogiques, que j’ai vraiment pris goût à la musique électronique. Donc ce n’était pas une volonté de laisser tomber la guitare, mais plutôt une évolution naturelle, poussée par les circonstances. J’ai mis du temps à trouver ce qui me convenait, mais au final, ça s’est fait comme ça.

Quand on joue de la basse ou de la guitare au sein d’un groupe, il y a un aspect très scénique, une certaine présence sur scène qui va avec l’instrument. Est-ce que c’est quelque chose dont tu voulais aussi te défaire avec ce projet, ou ce n’était pas une réflexion en soi ?
Oui, clairement. Après 20 ans de concerts dans des groupes rock, j’avais pris l’habitude, mais ce n’était pas forcément quelque chose de naturel pour moi. Je n’ai jamais été du genre à secouer la tête ou à haranguer la foule en criant ‘vous êtes chauds ?!’. Ce n’est pas mon truc. Je n’ai pas de problème à monter sur scène, je n’ai pas le trac et j’ai hâte de proposer une musique que je puisse jouer en toute sobriété. D’ailleurs, je plaisante souvent en disant que je vais enfin pouvoir ‘faire la gueule sur scène’ ! Il y a un peu de ça, en fait. J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer en groupe, sinon je ne l’aurais pas fait aussi longtemps. Mais quelque part, ce n’était pas totalement dans ma nature. Finalement, est-ce un nouveau moi ou celui qui sommeillait depuis longtemps ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c’est que j’appréhende un peu les lives en solo. Quand il y a un problème technique, on est seul pour gérer. Et ça arrivera, forcément. Il n’y a plus les copains autour d’une bière pour dédramatiser ! Quand tu vois qu’il y a seulement 4 ou 5 personnes à ton concert, ce qui peut arriver, tu te dis ‘bon, merde…’. Et quand ils sont 2000 – ce qui n’arrive pas souvent – c’est une autre sensation. Je ne sais pas encore ce que ça va donner de me retrouver seul sur scène. Mais j’ai envie d’essayer, alors on verra bien.
Tu es bassiste, mais est-ce que la basse – ou même la guitare – t’a servi à enrichir ta musique actuelle ? J’ai remarqué un vrai travail sur les basslines dans tes morceaux, elles prennent autant d’ampleur que les synthés et les mélodies. Est-ce que ton passé de bassiste a influencé cette approche ?
C’est tout simplement comme ça que je me suis construit. Je suis autodidacte dans tout ce que je fais, même dans mon boulot. J’ai toujours appris en me plongeant à fond dans un sujet, sans suivre une approche scolaire. J’ai commencé la musique comme ça aussi : j’ai bossé un été pour m’acheter une basse et monter un groupe de métal avec un pote. Puis, à force de jouer, de travailler d’arrache-pied, j’ai développé ma propre approche, toujours en autodidacte. Donc forcément, ma construction musicale s’est faite à travers le jeu en groupe, les musiques extrêmes et la basse. Aujourd’hui, je ne saurais pas dire précisément en quoi ça influence ma musique. La manière dont j’ai appris ressort forcément dans ce que je fais aujourd’hui, même si je ne saurais pas toujours l’expliquer.
Pour revenir à ‘Dever To Laye’, j’ai vu que ça fait référence à un village en Auvergne, appelé Vertorlaye. Qu’est-ce qui s’est passé là-bas ?
Quand je prononce le nom Dever To Laye, ne le dis jamais exactement de la même manière. Trouver un nom, c’est toujours un peu étrange, parce qu’on doit le porter aussi longtemps que le projet existe. Je ne voulais pas non plus lui accorder une importance démesurée… mais malgré tout, il y a quelque chose. Dans mon dossier de presse, je parle notamment d’une démarche artisanale, d’un retour à un travail très personnel, individuel. Vertolaye, ce n’est pas exactement le village où j’ai grandi, mais c’est celui où je passais tous mes week-ends à mourir d’ennui. Toute ma famille y était : mes parents, mes grands-parents, mes oncles et tantes… Dans la maison de ma grand-mère, il y avait l’atelier de menuiserie de feu mon grand-père, c’était mon seul remède à l’ennui quand j’étais enfant. J’adorais y aller, récupérer des chutes de bois, utiliser des ciseaux à bois… Avec mon frère, on gravait nos prénoms dessus, ce sont des souvenirs très marquants. Ce village a une vraie histoire pour moi, mais il porte aussi en lui-même une certaine dimension politique dans le sens où il n’est tenu en vie que grâce à l’existence d’une usine Sanofi. C’est un endroit où il ne se passait pas grand-chose, où l’on pouvait avoir ce sentiment de vide, presque dramatique. Son existence même dépendait du bon vouloir de cette industrie pharmaceutique. J’y ai passé énormément de temps à m’ennuyer et à cogiter. Ce village fait partie de moi, sans que je veuille non plus en faire un symbole trop lourd. Mais ça m’a semblé naturel de lui donner ce nom. C’est difficile à expliquer, mais il y a quelque chose de grave, presque brut. Cet endroit me rappelle une époque où il n’y avait rien à faire, où le vide était omniprésent. L’existence même de ce village me semble dramatique, parce qu’aujourd’hui, il ne subsiste que grâce à la présence de cette usine pharmaceutique. J’y ai passé énormément de temps à m’ennuyer, à cogiter. Peut-être que, gamin, cette sensation était encore plus marquante. Aujourd’hui, je ne voulais pas non plus en faire un symbole trop appuyé, mais donner ce nom au projet m’a semblé juste.
Est-ce que ce n’était pas aussi une manière de combler un vide, de lui donner une forme de consistance ?
Je ne me dis pas que ma musique va donner un sens à ce village, mais d’une certaine manière, j’avais envie de lui rendre quelque chose. Je ne sais pas si c’est bien formulé comme ça, mais il s’est vraiment passé un truc fort quand j’étais gamin. Quand je repense à cette image de moi, à 7 ans, avec ces ciseaux à bois… Et quelque part, bien plus tard, à 31 ans, j’ai passé un CAP d’ébénisterie. C’est une passion qui ne m’a jamais vraiment quitté. Il m’a fallu des années pour reconnecter tout ça, aussi bien dans ma musique que dans mon parcours professionnel. J’ai un parcours assez chaotique, et j’ai longtemps bataillé pour revenir vers un travail plus manuel, plus artisanal. Tout ça s’est construit au fil du temps, et à un moment, j’ai ressenti ce besoin de retour aux sources. Mais en même temps, je ne veux pas non plus donner trop de poids à ce nom. J’ai hésité avec d’autres, et au moment de choisir, il y avait presque une forme de détachement. Je ne sais pas où ce projet va aller, ce qu’il deviendra demain. Ce nom me plaît, mais il ne doit pas être une revendication absolue. C’est un hommage à ce village, mais ça restera un élément parmi d’autres dans mon parcours.

Tu évoques cette notion d’artisanat. Est-ce que, justement, dans ce projet, il y a cette volonté de se détacher de l’ego et des standards ? Ça m’a fait penser au mouvement Fluxus, où l’œuvre créée avait moins d’importance que l’ambiance dans laquelle elle était produite. Est-ce que cette démarche résonne avec ce que tu as voulu faire ?
Oui, complètement. Il y a cette volonté de se défaire de l’ego et des standards, mais aussi de créer dans un cadre qui me correspond, sans que le résultat final soit le seul objectif. Je ne fais pas de musique pour rencontrer des gens, mais les rencontres font partie du processus. Ce projet, je le fais avant tout d’une manière qui me semble juste, pour me sentir bien avec moi-même, après avoir traversé différentes étapes, comme avec Cymbaline qui était un groupe très calibré, très pop. J’aime beaucoup ce que nous avons fait, mais ce n’était pas vraiment d’où je viens. Un groupe, par définition, ne ressemble pas uniquement à moi, il est aussi l’expression des autres membres. Et quelque part, ce projet était un peu plus réfléchi, plus pensé pour fonctionner. Avec ce projet actuel, bien sûr, j’espère que mes chansons sont agréables à écouter, qu’elles touchent quelque chose, mais je ne crée pas uniquement pour le résultat final. Ce qui m’importe, c’est aussi la manière dont je le fais, avec une forme d’intégrité. C’est en ce sens que ça rejoint l’idée du mouvement Fluxus que tu évoques.
Parlons de tes morceaux sur ‘INIT’. Comment t’es-tu préparé pour produire ce projet ? Est-ce que tu as fait des essais, des sortes de prototypes avant d’arriver à la version finale ?
En général, je commence avec une grille d’accords que je programme en MIDI, comme un piano, pour avoir une base. Ensuite, en fonction du matériel que j’ai à disposition, je teste différentes façons de l’enregistrer. C’est souvent une question d’expérimentation. Quand j’ai trouvé ma configuration avec le Prophet 5 et le SYNTRX, je me suis dit OK, là, je tiens quelque chose, surtout pour le live. À ce moment-là, j’ai eu la certitude que cette configuration serait la bonne pour un moment, en tout cas. Ce qu’on entend dans l’album, c’est presque exclusivement issu du Prophet 5 et du SYNTRX, à part quelques chœurs qui ont été très retravaillés avec des reverbs.
Dans certains morceaux de l’album, on ressent une progression lente, avec des mélodies qui oscillent avant de laisser place à des textures de plus en plus envahissantes, menant souvent à une forme de climax, notamment sur tes titres les plus longs comme “Initial” ou “Render”
Dans les morceaux qui suivent, oui, je reste clairement dans la même veine, mais j’ai joué un peu plus avec des ups and downs, des variations. Pour cet album, j’avais vraiment envie de créer quelque chose pensé pour le live, où tu es dans l’attente, tu attends encore et encore, sans savoir exactement quand ça va arriver… et puis ça arrive. Je voulais garder cette simplicité, sans chercher à complexifier les morceaux inutilement et utiliser la répétition la redondance. Alors, est-ce que ça va vers un climax ? Je ne sais pas. Mais ce que j’espère vraiment – et le vrai test, ce sera le live – c’est que cette approche fonctionne et que les gens ne s’ennuient pas.
Ca fait plusieurs fois que tu me parles de performance live, ça semble être un pilier important dans ta création. Est-ce que tu as produit INIT en pensant pour le live ?
J’ai vraiment estimé que le projet était prêt quand j’ai trouvé ma configuration idéale pour le live. C’est clairement cette dimension qui prend le dessus, c’est ce qui me fait le plus plaisir. Ce n’est pas un album destiné à rester enfermé dans mon home studio. J’ai envie qu’il soit écouté dans une dimension plus large. Je n’ai pas de grand discours à tenir sur l’artisanat, mais je pense à cette époque où les musiciens commençaient sans Internet, où tout se jouait différemment. Je n’ai pas forcément envie de faire des lives dans des grandes salles .Ce que j’imagine, ce sont des concerts en petit comité, 20 ou 30 personnes, avec un bon système son, une atmosphère plus intime. Je ne sais pas encore exactement sous quelle forme, mais ce qui m’intéresse, c’est de casser les automatismes de l’écoute, d’éviter ces soirées où trois groupes s’enchaînent et où tu oublies déjà le premier à la fin du second. Ce projet, il doit vivre à travers le live. S’il ne finit que sur Spotify, je ne suis pas sûr qu’il soit très intéressant.
Dans ton processus de création musicale, est-ce que tu retrouves des similitudes avec ton travail de maquettiste ou de prototypiste ? Ta démarche est-elle différente dans ces deux domaines, et si oui, en quoi ?
L’approche n’est pas fondamentalement la même, je ne crée pas ma musique en m’appuyant sur les méthodes que j’utilise en architecture. Par contre, c’est un métier avec un rythme soutenu et un niveau d’exigence important. C’est une chance pour moi, vu mon parcours professionnel, d’en être arrivé là. Je me plais dans ce job, et j’avais ce challenge à relever, ce qui m’a demandé de travailler énormément, d’apprendre, de progresser. Et il se crée une énergie dans ces moments-là et c’est cette énergie qui rejaillit sur ma musique. Je me rends compte que les moments où j’ai été prolifique en musique coïncident souvent avec ceux où je me suis énormément donné au boulot. Je me mets dans une dynamique de travail intense. A une époque, j’enchaînais 60 à 70 heures par semaine très régulièrement. Je rentrais chez moi vers 23h, mais je passais encore trois ou quatre heures à faire de la musique. Tu es dans une énergie, un état où tu donnes énormément au boulot, tu réussis, tu es fatigué, mais c’est justement dans ces moments-là que tu vas donner le meilleur de toi-même. C’est dans ces périodes où tu te sens poussé à fond que tu trouves des choses intéressantes, en musique notamment. C’est un peu comme des vagues, il y a des phases où tu es à fond, puis tu te fatigues, tu fais une pause et tu reviens. Il y a une grosse corrélation entre le boulot et la musique pour moi. Cependant, je ne fais pas de passerelles directes entre la méthode ou le résultat du travail et ma musique. Il y a un côté très matériel dans l’architecture, et pour être honnête, je ne vois pas vraiment l’occasion de faire un lien. Par exemple, je ne vais pas prétendre que le béton brut qu’on a coulé la semaine dernière a inspiré une texture sonore de béton dans ma musique. Ça ne fonctionne pas comme ça pour moi, même si l’inspiration vient bien de quelque part.
Je trouve qu’il y a quand même un aspect important au niveau de l’environnement, des espaces, est-ce que ça fait sens pour toi comparé à l’architecture ?
Je pense que ça a quand même du sens, oui, il y a des passerelles qui sont possibles. D’ailleurs, tu parlais tout à l’heure de la musique pour une expo que j’avais faite, parce que c’était pour l’agence d’architecture pour laquelle je travaille. On avait organisé une exposition très particulière, et j’ai pris énormément de plaisir à la faire. C’était au Musée d’art contemporain de Bordeaux, un ancien espace industriel portuaire, où on déchargeait peut-être des bateaux, je ne sais pas. Mais il est devenu un musée. Le lieu était immense, avec des voûtes et une acoustique très marquée. On y avait emmené des machines de prototypes de l’École Polytechnique de Zurich, des objets curieux qui produisaient tous du bruit. Au début, on m’avait dit de ne pas faire de la musique, et j’ai dit “Ok”, mais en fait, il y avait ce bruit dans ce lieu avec une acoustique très forte. Ce qui n’allait pas, c’est qu’il y avait des bruits partout. La musique consistait donc à faire du bruit, quasiment, avec des notes très lointaines. J’ai écarté les phases au maximum, et on a mis deux enceintes face à face dans les gaines d’aération, pour que, lorsque tu entrais dans l’espace, tu entendais un son qui reliait toutes les machines, mais tu ne pouvais pas localiser la provenance, car ça se diffusait partout. J’ai trouvé ça génial, mais c’était parce qu’il y avait une raison, une opportunité. Ça a marché. Mais je pense qu’il ne faut pas toujours forcer le lien, comme vouloir que ma musique colle aux grands espaces. Parfois, ce lien se crée naturellement.
La vidéo de ton morceau “Closed Polysurface” m’évoque beaucoup de choses : la douceur, le béton, la force concentrique. Comment as-tu construit le clip ?
Cà c’est clairement une de mes névroses d’apprentissage de mon métier. Comme quoi il y a une passerelle qui se fait en fin de compte, de manière plus ou moins consciente. Les deux premières années où je faisais ça, je travaillais tellement que j’en rêvais la nuit. Je faisais des cauchemars de dessins, de formes, de volumes, des problèmes de la journée que tu résous la nuit, alors tu ne dors plus pour ne pas oublier le truc, et ça te rend un peu zinzin. Donc je voyais des cubes et des cubes sur le logiciel, le cube de béton, et je me suis dit, allez, on va l’extérioriser. Closed polysurface c’est donc ça. Ca m’amusait de me dire que finalement ces cubes, ils sont là et la boucle est bouclée.

Dever To Laye “Closed Polysurface“ réalisé par Adrien Brunel, à paraître sur l’album INIT
Sortie le 26/03/2025 sur Autoscopy Records
Précommander l’album : https://devertolaye.bandcamp.com